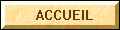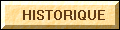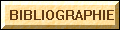|
J'ai toujours
regretté que lorsqu'on glorifie les trois frères
la Rochejaquelein, leur mère soit passée sous silence.
A peine cite-t-on quelques dates, fait-on référence
à la généalogie : Agrippa d'Aubigné,
les Surgères, ou une allusion à La Durbelière.
Ils lui ressemblaient pourtant ses trois fils, surtout l'aîné
"son Henri", son portrait fidèle, au physique
comme au moral.
Elle, qui leur avait déjà tant donné, souffrit
et mourut de vouloir leur donner encore davantage.
Si farouche qu'elle fut, cette volonté, non seulement fut
anéantie, mais elle fit place àune tragique abnégation.
C'était il y aura bientôt deux siècles. Nous
sommes le 4 décembre 1798 à la plantation du Baconnois,
à la limite du quartier de Nippes, paroisse de l'Anse-à-Veau,
en Saint-Domingue.
Les premières lueurs de l'aube paraissent derrière
le Mont de la Selle. Sur une méchante couchette, un lit
bas, étayé de bambous, une femme est demi-assise.
Seule, à peine la cinquantaine, les cheveux gris, le nez
délicatement retroussé, les sourcils arqués,
un gracieux visage.
Mais les joues sont creuses, le teint plombé. La sueur
coule sur son cou, inonde sa gorge recouverte d'un mince châle
de batiste.
Les yeux grand ouverts balaient lentement les entours : la chambre,
dans l'angle le moins encombré d'une vaste case, les murs
de torchis à colombages qui portent des traces de badigeon
rosé, un crucifix d'ivoire, ce qui reste d'un miroir brisé.
Les meubles comme les huisseries, sont d'acajou brut, sauf ce
petit bureau en loupe d'Amboine, marqueté de bois de rosé,
que lui a donné Madame de Spechbach. Un petit cabinet,
à droite, au fond de la ruelle. Ailleurs, une dodine disjointe,
des amas de calebasses, des petits barils de clairin, des coffres
entrouverts regorgeant d'on ne sait quoi. Au ras du sol en terre
battue, couleur d'ocré brune, un boucan fume sous une galette
de cassave et de citrons verts.
Le plafond crevé dévoile un toit d'essentes clissées
et bousillées.
Par delà la véranda, faite de quatre troncs de campêche
avec un petit fronton, une grande cour autour de trois citernes
de pierre, puis les grands caillés de la plantation, tout
en long, les murs à claire-voie, les toitures en feuilles
de bananier recouvertes d'une espèce de chaume, dont des
touffes sont, de place en place, arrachées. Une unique
vache, la dernière, meugle lamentablement. Deux coqs Bantham
se battent avec frénésie.
Au nord, en contre-bas, s'allonge une plage de gros sable blond.
Il y a quelques jours seulement, elle y ramassait les plus beaux
coquillages lambis pour les envoyer à sa première
petite fille, Constance Guerry, la seule qu'elle aura connue.
Elle est, avec ses parents et les Chabot, à Kiss-Ber, chez
l'évêque de Gyôr. Sans doute neige-t-il maintenant
en Hongrie. De toutes façons, il y fait meilleur qu'ici,
avec cette insupportable chaleur.
Au delà de la plage, la mer intérieure de Gonave,
une grande tâche indigo aux friselis d'argent.
Ensuite, loin dans l'espace, loin dans ses souvenirs, il y a la
Jamaïque, Kingston... Déjà presque six ans
qu'elle y parvint, avec son époux et Louis, son fils cadet.
Kingston où elle dut patienter huit mois avant de débarquer
à Port-au-Prince, le 19 septembre 93. Jour de chance, jour
de gloire aussi. En Vendée c'est la victoire de Torfou.
Pour elle ici, pour eux là-bas, le même destin :
un jour le rêve, lendemain la chimère.
Au cul de la maison, une prairie toute verte grimpe vers des rangs
d'orangers chargés de fruits, des ananas, un champ de cannes,
quelques arbres à pain. Le long d'une file de palmiers
Chamerops dégringole une ravine emplie d'un filon rougeâtre.
On saura plus tard que c'est de la bauxite, de l'aluminium presque
pur, mais personne ne sera là pour l'exploiter.
Encore plus haut, le regard bute sur les mornes de la Hutte. Le
regard, mais non la mémoire, car Constance connaît
chaque colline, chaque sentier, chaque arbre, chaque ruisseau
du versant opposé, jusques aux portes de Saint-Louis, de
Jacmel ou de Port-Salut.
Durant trois années, de l'été de 95 à
celui de 98, avec son mari et son fils elle combat dans la brousse
des Rivaux.
Une légion
de 900 royalistes, des Créoles, l'Infanterie de Marine
du comte d'Hector et les Maquisards du Mulâtre Rigaud, les
Noirs de la province du sud, ci-devant esclaves, que le décret
de 91 a affranchis sur la proposition de Louis XVI et non de l'évêque
Grégoire, ce paltoquet dont on ne doit retenir qu'il fut
le premier des prêtres jureurs.
Dans son quartier général de Pestel, Constance n'est
qu'à 5 milles au dessus du Baconnois. Elle ne la peut voir,
nichée qu'elle est dans son vallon, mais elle sait qu'elle
est là, toute proche, sa terre d'au delà des mers,
dans sa famille déjà pour la troisième génération,
sa fortune dotale, les belles espérances de ses enfants,
1 200 acres de bonne terre des Isles, qui, hélas, ne rendent
plus.
Les Compagnons ne peuvent ni défendre ni libérer
le Roy. Au moins veulent-ils faire payer leur crime à ces
Parisiens, ces Carmagnols régicides que la Convention envoie
à Saint-Domingue, pleutres et concussionnaires, capables
de rien, sinon de piller et de se trahir les uns les autres.
Constance organise Pestel, aligne les cases, nettoie les rues,
construit des cuisines, élève une infirmerie ; elle
uniformalise les tenues hétéroclites des partisans,
ceux-ci trop enclins à s'affubler de cordons, de bandoulières
fleur-de-lysées, de croix de Saint-Louis de pacotille.
Elle file, tricote, coud, ravaude, panse les blessés, frotte
les galeux à l'onguent de storax. Elle achète des
fusils à Philadelphie, du soufre en Louisiane, récolte
le salpêtre des nitrières naturelles, fabrique de
la poudre, fond des balles.
Louis fait faire l'exercice, apprend aux recrues le maniement
d'armes. Le Marquis mène les opérations de commando
; spécialiste de la guérilla nocturne, il remporte
de nombreux succès dans la plaine du Cul de Sac.
Durant trois ans Constance est l'âme de cette petite armée,
adulée plus que respectée, obéie parce qu'admirée,
accueillie, acceptée, adoptée enfin par les Noirs
comme une des leurs, une Passionnaria blonde dans une négresse
blanche.
Avec eux son époux nettoie la rive nord de la Province
Méridionale, conquiert Port-Salut, Téburon et met
le siège devant Jérémie qui vient d'être
abandonné par les Anglais.
La conduite de ceux-ci, pourtant nos alliés, est, comme
souvent, pour le moins ambiguë. Ce sont justement leurs tractations,
leurs exigences d'un monopole commercial, assorties de la reconnaissance
de Toussaint-Louverture comme Roi d'Haïti, qui mettent fin
à l'épopée de la Vendée Noire. La
résistance est impossible, les créoles sont désarmés,
les noirs, dépités.
Les premiers s'enfuient, mais les Anglais refusent de les prendre
à leur bord. Ceux qui réussissent à s'échapper
le font par leurs propres moyens, de mauvaises barques sur une
mer démontée. C'est le cas du Marquis et de Louis,
le 2 novembre 97.
Constance a prévu cette épreuve. Elle n'en est pas
surprise. Les Anglais lui ont déjà confisqué
ses récoltes de sucre. Chez ses aïeux, les La Roche-Allard
et les Caumont d'Ade, on courrait sus aux navires britanniques,
une habitude, devenue une compétition, un tournoi, presqu'un
jeu, tous respectant le même code d'honneur, Royaux ou Corsaires,
Français ou Anglais.
Mais le Roy de ces gens-là avait déjà trompé
les Vendéens. D'abord à Granville où était
son Henri, puis à l'île d'Yeu, à Saint Jean
de la Guadeloupe, et surtout à Quiberon où sont
morts les frères de son gendre Guerry, et aussi tellement
de cousins, de parents, une majorité de Poitevins.
Honte au Roy George, de sang Plantagenêt, Comte héréditaire
de Poitiers, de ne pas avoir prêté à ses vassaux
le secours qu'ils lui demandaient, le pire manquement au devoir
Féodal.
Et Constance reste seule à Saint-Domingue, forte de son
droit. Elle descend au Baconnois, y entre pour la première
fois, referme la porte, enfin chez elle, pour un mois. Un mois
à supporter la séparation d'avec tous ses êtres
chers.
Le jour est maintenant levé avec la brise de mer qui agite
les fleurs des flamboyants, les rayons du soleil jouent dans les
buissons ébouriffés d'Hibiscus, de Balisiers, de
Pommes-Cannelles. Josepha, la fidèle mulâtresse,
arrive, elle a prévenu les amis, les Compagnons d'armes,
Rimbert, Sennebries, Rigaud, les derniers serviteurs.
Minée par une fièvre horrible, Constance étouffe,
ses yeux se fixent, ses lèvres vont se sceller sur un dernier
signe de croix.
"Mon
cher Henri ! Quelle joie de nous revoir !
Recevez-moi, Seigneur. Faites que j'aie enfin froid,
Comme jadis, quand nous étions tous à la Durbelière."
Août 1998 - Antoine Bergeron
|